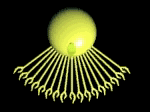Dès le début de l’histoire égyptienne, les artistes peintres ont tout inventé, que ce soit le relief peint, la peinture sur enduit mural (que trop souvent et erronément l’on appelle fresque, alors que, techniquement parlant, ce sont des peintures à la détrempe) ou, on le sait peut-être moins, la peinture sur toile. Des fragments de pièces de lin, datant de l’époque pré-dynastique (Nagada II) et représentant un bateau et des rameurs sont en effet conservés au Musée égyptien de Turin : ils furent exhumés sur le site de Gebelein, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Louxor, par Ernesto Schiaparelli au début du XXème siècle.
J’ai déjà eu l’occasion de mentionner que le relief sculpté avait constitué, à l’Ancien Empire, l’art essentiellement dominant, laissant par là même à la peinture la fonction de simple coloriage. En revanche, au Nouvel Empire, en fait à la XVIIIème dynastie, la peinture commence réellement à se démarquer des codifications antérieures, atteignant alors sa plus libre et sa plus forte expression. Nous sommes à cette époque précise véritablement à l’acmé de cette formidable fécondité créatrice que, de tous temps, l’Egypte a connue.
Des conditions économiques et sociales favorables ne sont évidemment pas étrangères à cet extraordinaire développement. Et je ne résiste pas à reproduire ci-après, in extenso, la très éloquente description qu’en donne feu l’égyptologue belge Roland Tefnin, spécialiste incontesté de la peinture thébaine qui, bien mieux que moi, vous fera comprendre l’environnement dans lequel évoluèrent les artistes de ce temps :
Dans l’ambiance mondaine, citadine, prospère, festive, voluptueuse, féminine qui fut celle de la XVIIIème dynastie, au moins à partir du moment où l’élan des conquêtes se mua en jouissance, soit au tournant des règnes d’Aménophis II et de Thoutmosis IV, l’art pictural, art délicat, subtil, fragile, si apte à rendre la transparence frémissante d’un vêtement de lin fin, la vibration d’une perruque (...), le fondant d’un parfum dans la chevelure et sur les épaules d’une belle, les nuances bleues et blanches d’un calice de lotus, cet art de la pure picturalité fut apprécié comme jamais.
J’ai déjà eu aussi l’occasion d’attirer votre attention, ami lecteur, sur le fait que, littéralement, dans la langue égyptienne, le peintre se disait : "scribe des contours", "traceur des contours"; formulation loin d’être anodine dans la mesure où cet artiste était bien plus en fait un graphiste qu’un véritable coloriste; ce qui prouve, une fois encore, l’étroite relation existant entre écriture et peinture.
Avec le temps, il abandonna de plus en plus l’utilisation quelque peu rigide des couleurs de base - comme sur notre bas-relief aux poissons évoqué le 1er juillet dernier- pour se tourner vers un art plus élaboré, plus personnel parfois, débouchant même sur des notations quelque peu "surréalistes" : c’est ainsi que l’on vit apparaître des hérons bleus ou des chevaux roses !
Mais quelle que soit l’époque, l’artiste égyptien n’eut qu’à se pencher pour ramasser dans la nature les matériaux, très simples en définitive, qui constituèrent sa palette.
Ainsi le blanc, qu’il obtient soit à partir de calcaire broyé provenant de la Vallée du Nil (carbonate de calcium), soit à partir de plâtre issu de la cuisson du gypse (mélange de sulfate de calcium et de carbonate de calcium portés à une température d’environ 130°) provenant de la mer Rouge, du Fayoum ou du désert (sous forme alors de roses des sables).
Le noir, soit à partir de carbone sous forme de charbon de bois ou de suie, soit d’oxyde de manganèse appelé pyrolusite.
Si l’on considère que le blanc et le noir ne sont pas de vraies couleurs, quatre autres pigments de base se retrouvent dans les cupules des peintres antiques, quel que soit leur style :
Le bleu, issu du silicate de cuivre et de calcium artificiellement obtenu par cuisson (mélange de malachite, de poudre calcaire et de sable) : c’est ce que, traditionnellement, les égyptologues appellent le "bleu égyptien".
Le vert, provenant de la malachite trouvée dans le désert arabique ou dans les mines de cuivre du Sinaï.
Le jaune, obtenu à partir d’oxyde de fer plus ou moins hydraté présent aux environs du Caire et dans les oasis du désert libyque; donnant l’ocre jaune qui, par convention, rendait la chair des femmes.
Et le rouge, l’ocre rouge, provenant d’oxyde de fer anhydre abondant en Moyenne Egypte, du côté de Tell el-Amarna et dans les oasis; et qui, suivant la même codification, rendait la peau des hommes.
Remarquons que par rapport aux teintes qui forment de nos jours la palette chromatique, seul le violet n’était pas représenté dans l’Egypte antique. Il faudra attendre l’époque gréco-romaine pour le voir apparaître sur les murs des tombes.
Afin d’accentuer la résistance de sa peinture (ou de son encre, d’ailleurs), l’artiste égyptien broyait ces substances afin d’avoir une poudre qu’il mélangeait avec l’eau, et à laquelle il ajoutait un fixatif, très souvent une gomme végétale qu’il est convenu d’appeler gomme arabique et qui provient directement des nombreux acacias de la région de Louxor. Cette pâte constituée, il la modelait de manière à se confectionner soit un petit pain conique, soit une pastille qu’il déposait dans les godets (les cupules, disent les égyptologues) de sa palette.
Et c’est après avoir trempé dans l’eau une fine tige de jonc taillée en biseau, puis mâchonnée et "battue" de façon que ses fibres se séparant forment alors un vrai pinceau et après l’avoir ensuite frotté sur le colorant séché qu’il peut enfin appliquer sa couleur.

J’aurai évidemment l’opportunité d’y revenir quand, ensemble, nous visiterons la salle 6 du Département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, mais voici déjà, pour illustrer mon propos, la représentation d’une palette de peintre, au nom du roi Séthi Ier, exposée dans la deuxième vitrine, et répertoriée sous le numéro d’inventaire N 2 274.
Et pour bien insister une dernière fois sur l’étroite corrélation qui existait entre peinture et écriture, je vous propose ci-après le hiéroglyphe ![]() qui servait à exprimer le verbe écrire, ainsi que d’autres termes de la même famille : vous remarquerez aisément qu'il présente, évidemment schématisés, la palette de l’artiste, avec les godets destinés aux pastilles de colorant, le petit récipient pour l’eau et le pinceau de jonc.
qui servait à exprimer le verbe écrire, ainsi que d’autres termes de la même famille : vous remarquerez aisément qu'il présente, évidemment schématisés, la palette de l’artiste, avec les godets destinés aux pastilles de colorant, le petit récipient pour l’eau et le pinceau de jonc.
A ces artistes peintres dont, par parenthèses, pour la plupart d’entre eux, nous ignorons le nom, était dévolue la décoration des tombes de personnages illustres, pharaon et famille royale en tête, situées, à la XVIIIème dynastie, dans la montagne thébaine (Vallée des Rois et Vallée des Reines.)
Le travail d’application de la peinture différait évidemment selon la constitution de la roche. Et de toute manière, préalablement à la décoration, il fallait préparer les murs. A Thèbes, par exemple, les tombes étant le plus souvent creusées dans de la roche calcaire, il était obligatoire d’épaissir les parois, trop friables ou trop irrégulières : dans le premier cas, des hommes les lissaient puis y appliquaient une couche de gypse; dans le second, ils les égalisaient en les enduisant d’une couche de limon du Nil (mélange de sable et d’argile composée d’un peu de carbonate de calcium naturel et de gypse) et de paille hachée, pour ensuite appliquer une couche de finition en gypse de plus ou moins deux millimètres.
Ainsi préparé, ce fond apparaît en soi généralement blanc, opaque, mat. En fait, il s’agit d’une illusion d’optique dans la mesure où l’artiste le teintait légèrement soit de gris, soit de bleu, désireux qu'il était de mieux mettre en évidence les pagnes ou autres vêtements vraiment blancs, eux, qui allaient habiller les personnages représentés.
Il faut savoir que la plupart des peintures des hypogées thébains sont restées visiblement incomplètes et que, même si toutes les parois sont décorées, l’artiste, volontairement, a laissé au moins un détail à l’état d’ébauche. Il est dès lors aisé pour les égyptologues, en tirant parti de cette décoration inachevée, de déterminer les étapes successives de son exécution.
Laissons de côté les esquisses retrouvées sur ostraca, et envisageons tout de go la paroi murale proprement dite. Sur chaque portion, l’artiste traçait tout d’abord des lignes horizontales afin de séparer les registres. A l’intérieur de ces différentes zones, pour les scènes les plus importantes, il établissait un quadrillage. Tout ce réseau était obtenu en claquant sur la paroi une corde extrêmement tendue qu’il avait pris soin de tremper dans la peinture rouge.
Il est à ce point de vue intéressant de constater une inversion des conventions par rapport à notre modernité : si nous écrivons en noir, c’est en rouge que nos fautes sont corrigées. En Egypte, c’était exactement le contraire : les esquisses se faisaient en rouge et, si besoin de correction il y avait, le maître les effectuaient en noir.
La paroi ainsi délimitée, la décoration, peinture à la détrempe - je le rappelle - appliquée sur enduit sec, était alors réalisée en grands aplats de couleur, sachant que les détails viendraient s’ajouter par la suite.
Parfois, certains d'entre eux, plus particuliers, furent protégés ou rendus volontairement brillants soit par une couche de cire d’abeille, soit par une de vernis transparent à base de résine naturelle ou de blanc d’oeuf. Malheureusement, après autant de siècles, les uns ont noirci quand d’autres sont devenus cassants, détachant la peinture de pans parfois entiers de paroi.
Il serait donc plus que temps que les générations à venir, après avoir contemplé l’image égyptienne, après avoir constaté qu’elle se détruisait, puissent d’une manière ou d’une autre la sauver. Vous vous doutez bien, ami lecteur, que ce travail de sauvegarde a déjà commencé, mais que malheureusement faute de moyens le plus souvent, de main d’oeuvre véritablement spécialisée aussi parfois, il n’avance guère aussi vite que ne le requerraient l’importance des dégâts et le désir de tous les amateurs d’art que nous sommes ...
(Dominicy : 1994, 51-7 ; Mekhitarian : 1978; Merchez-Van Essche : 1994, 57-65 ; Peck : 1980, 30- 42 ; Tefnin : 1997, 3-9)
Je dédie ce modeste article quelque peu technique à tous mes amis et connaissances, belges ou étrangers, lecteurs de ce blog qui, peu ou prou, s’intéressent à la peinture, mais sont surtout artistes dans l’âme afin de répondre aux interrogations qui sont les leurs concernant les précurseurs que furent les Egyptiens dans cet art.







 et de celui du collier d'or réunis en un monogramme), liait la personne royale à celle de l'Horus solaire et céleste.
et de celui du collier d'or réunis en un monogramme), liait la personne royale à celle de l'Horus solaire et céleste. (= "
(= "










/image%2F1490195%2F20180316%2Fob_343836_van-gogh-le-pont-du-carrousel-et-le.jpg)