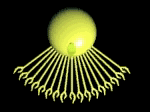Le long texte que je vous propose aujourd’hui, ami lecteur, va définitivement clore cette très diversifiée et foisonnante partie consacrée à la découverte de la salle 3 du Département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre; salle dédiée au Nil et qui, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, constitue véritablement une entrée en matière pour bien comprendre l’histoire de cette civilisation antique.
Ce morceau d’anthologie - dont on a abondamment retrouvé trace - pas moins de quatre papyri dont le plus connu est celui du Musée de Turin (CGT 51 016), deux tablettes et soixante-neuf ostraca -, selon les propres termes de Bernard Mathieu qui a réalisé la traduction que je reprends ici, "s’affirme de toute évidence comme une composition littéraire soignée, avec ses quatorze stances bien équilibrées, sa construction logique (introduction, développement, conclusion) et ses nombreuses recherches stylistiques."
En outre, il se révèle extrêmement instructif, techniquement parlant, dans la mesure où les scribes qui l’ont recopié, et c’est suffisamment rare pour être épinglé, l’ont assorti de rubriques et de points rouges.
Je m’explique : le terme "rubrique" provenant du latin rubrica qui signifie terre rouge, ocre, désigna dès le Moyen Âge, les titres, inscrits en rouge, donnés aux livres de Droit.
Les égyptologues, quant à eux, utilisent ce terme pour différencier le début d’une stance, écrite en rouge, de la suite des vers, écrits en noir. (Une stance étant un ensemble cohérent de plusieurs distiques, c’est-à-dire de plusieurs couples de deux vers.)
Quant aux points rouges, on les retrouve à la fin de chaque vers, symbolisant à ce titre une volonté de marquer un arrêt dans le rythme, et probablement une chute de la voix au niveau de la mélodie.
Pour la première fois, donc, apparaît cette sorte de ponctuation qui, la traduction des hiéroglyphes terminée, permet d’instaurer des séparations entre les vers et d’ainsi mieux comprendre le développement des idées véhiculées par le texte lui-même.
HYMNE A LA CRUE DU NIL
HYMNE A HÂPY
1.
Salut à toi, Hâpy, issu de la terre
venu pour faire vivre l’Egypte,
Dont la nature est cachée, ténèbre en plein jour,
pour qui chantent ses suivants;
Qui inonde les champs que Rê a créés
pour faire vivre tous les animaux,
Qui rassasie la montagne éloignée de l’eau
- ce qui tombe du ciel est sa rosée;
Aimé de Geb, dispensateur de Népri,
qui rend florissants les arts de Ptah !
2.
Maître des poissons, qui conduit au sud le gibier des marécages
- il n’est pas d’oiseau qui descende aux temps chauds;
Qui a fait l’orge et produit le blé,
approvisionnant les temples.
Tarde-t-il que le nez se bouche,
et que chacun est démuni;
Si l’on réduit les pains d’offrande des dieux, des millions d’hommes sont
perdus !
3.
Parcimonieux, le pays entier souffre,
grands et petits vagabondent;
Mais les hommes se rassemblent dès qu’il s’approche,
lorsque Khnoum l’a formé.
Se soulève-t-il que le pays est dans l’exultation,
et que chacun est en joie;
Chaque denture entreprend de rire,
et chaque dent est découverte !
4.
Qui apporte la nourriture, fertile en aliments,
et a créé tous ses bienfaits;
Maître de l’autorité, au doux parfum,
c’est la satisfaction lorsqu’il vient.
Qui produit l’herbe pour les troupeaux,
et donne des victimes à chaque dieu.
Il est dans la Douat, ciel et terre sur ses étais,
lui qui a pris possession des Deux Pays,
Qui a empli les magasins, élargi les enclos,
et donné des biens aux démunis.
5.
Qui fait pousser le bois et tout ce qu’on désire
- on ne peut en manquer;
Qui produit les bateaux de sa vigueur
- on ne peut en construire en pierre !
Qui prend possession des collines par son flot,
sans qu’on puisse l’apercevoir;
Qui oeuvre sans qu’on puisse le diriger,
qui nourrit en secret;
On ne connaît pas son lieu d’origine,
ni sa caverne, dans les écrits.
6.
Qui parcourt les hauteurs sans digue,
qui vagabonde sans guide,
C’est lui qu’accompagnent les groupes d’enfants,
on le salue comme un roi !
Dont la période est fixée, qui vient en son temps,
emplissant Haute et Basse-Egypte.
Chacun boit de son eau,
lui qui donne au-delà de sa beauté.
7.
Celui qui était dans le besoin accède à la réjouissance,
et chaque coeur se réjouit !
Qui a porté Sobek et enfanté le flot,
l’Ennéade qui est en lui est sacrée.
Qui arrose les champs, irrigue la campagne,
onguent pour le pays complet,
Qui enrichit l’un et appauvrit l’autre,
sans que personne lui en fasse procès;
Qui fait la satisfaction sans pouvoir être détourné,
à qui l’on n’impose pas de frontière.
8.
Qui éclaire ceux qui sortent dans leurs ténèbres
avec la graisse de ses troupeaux;
Tout ce qui est produit est sa vigueur,
il n’est pas de région qui vive sans lui.
Qui habille les gens du lin qu’il a créé,
qui agit pour Hedjhotep avec son oeuvre,
Qui agit pour Chesmou avec son huile,
tandis que Ptah façonne avec ses rejets.
[...]
et tous les ouvriers produisent grâce à lui.
Et tous les écrits en hiéroglyphes :
son affaire est le papyrus.
9.
Qui sourd du monde souterrain et sort du ciel lointain,
qui se révèle et sort du secret.
L’accablement est en lui de sorte que la population diminue,
lui qui la tue de sorte que l’année est funeste;
Les forts ressemblent à des femmes,
chacun a repoussé ses outils.
Il n’y a plus de fil pour les habits :
il n’y a plus de vêtement pour se vêtir ;
Les enfants des nobles ne peuvent se parer :
il n’y a plus de fard pour leur visage;
Les cheveux tombent par manque de lui :
personne ne peut s’oindre.
10.
Qui établit la justice dans le coeur des hommes
- ils disent des mensonges dans la pauvreté.
Qui se mêle avec le Grand Vert,
dont on ne dirige pas le cours.
On l’adore plus que tous les dieux,
lui qui fait descendre les oiseaux de leur pays.
Il n’est personne dont la main tisse de l’or,
personne qui s’enivre d’argent,
On ne peut manger de lapis-lazuli véritable :
l’orge est à la base de la prospérité.
11.
C’est pour lui qu’on commence à chanter à la harpe,
pour lui qu’on chante en frappant des mains;
C’est lui qu’acclament les groupes d’enfants,
c’est pour lui qu’on épuise des délégations.
Qui vient chargé de richesses, orne le pays
et rafraîchit le teint des hommes.
Qui fait vivre le coeur des femelles enceintes,
et désire la multitude de tous les troupeaux.
12.
Se soulève-t-il devant les citadins affamés,
qu’ils se rassasient de ses produits :
Des plantes-hen à la bouche, des lotus à la narine,
chaque chose abonde sur terre !
Tous les légumes sont à la disposition des enfants,
eux qui avaient oublié ce qu’était que manger;
Le bien est répandu dans les rues,
et le pays entier gambade.
13.
Gonfle-toi, Hâpy, que l’on te fasse des offrandes,
que l’on sacrifie pour toi des boeufs,
Que l’on accomplisse pour toi une hécatombe,
que l’on gave pour toi des volailles,
Que l’on capture pour toi les lions du désert,
que l’on te rende tes bienfaits,
Que l’on fasse des offrandes à tous les dieux,
comme on l’aura fait pour Hâpy :
Encens, huile fine, boeufs à cornes longues, courtes,
volailles en holocauste,qu’a faits Hâpy issu de sa puissante caverne.
On ne connaît pas son nom dans la Douat,
et les dieux ne peuvent le révéler.
14.
Vous tous, les hommes, exaltez l’Ennéade,
craignez son autorité !
Agissez pour son fils, le Maître Universel,
celui qui fait verdir les Deux Rives !
Sois vert et tu viendras, sois vert et tu viendras,
Hâpy, sois vert et tu viendras !
Viens en Egypte, toi qui produis la paix,
qui fais verdir les Deux Rives !
Sois vert et tu viendras, sois vert et tu viendras,
Hâpy, sois vert et tu viendras !
Toi qui fais vivre hommes et troupeaux
de tes produits champêtres.
Sois vert et tu viendras, sois vert et tu viendras,
Hâpy, sois vert et tu viendras !
(Traduction Bernard Mathieu : 1990, 137-41)
Parmi les nombreuses occurrences de cet hymne auxquelles je faisais allusion en début d'article, il faut maintenant compter, depuis avril 2007, suite à la mise en vente publique d'un lot de 171 ostraca ayant appartenu à la collection de l'égyptologue lyonnais Alexandre Varille (1909-1951), sur la présence d'un exemplaire au sein du Louvre (E 32 929). Toutefois j'ignore totalement si tout ou partie de cette manne acquise par le Musée et inventoriée E 32 887 à E 33 057 a été ou non ajoutée dans l'une quelconque vitrine.
Je compte bien m'en enquérir lors d'une visite que j'espère prochaine, à moins que l'un d'entre-vous, ami lecteur, détienne déjà le renseignement ...







 Le fleuve déborde, offrant à ses rives, sur quelques kilomètres de part et d'autre, non seulement l'eau tant attendue, mais aussi le limon fertilisant constitué des déchets et des débris rocheux qu'il arrache et charrie tout au long de son cours. Quant à la quantité d'eau apportée par la crue, elle dépend essentiellement de celle des précipitations que le fleuve a connues dans les montagnes d'Ethiopie.
Le fleuve déborde, offrant à ses rives, sur quelques kilomètres de part et d'autre, non seulement l'eau tant attendue, mais aussi le limon fertilisant constitué des déchets et des débris rocheux qu'il arrache et charrie tout au long de son cours. Quant à la quantité d'eau apportée par la crue, elle dépend essentiellement de celle des précipitations que le fleuve a connues dans les montagnes d'Ethiopie.






 Sur le fragment supérieur droit du bas-relief du Louvre, vous distinguerez seulement le pied gauche avancé du pêcheur, en ocre rouge, le bas du harpon, avec ses deux barbelures, tenu verticalement par son fils et l'avant de la barque se terminant, au niveau de la frise de droite, par l'ombelle stylisée d'un papyrus.
Sur le fragment supérieur droit du bas-relief du Louvre, vous distinguerez seulement le pied gauche avancé du pêcheur, en ocre rouge, le bas du harpon, avec ses deux barbelures, tenu verticalement par son fils et l'avant de la barque se terminant, au niveau de la frise de droite, par l'ombelle stylisée d'un papyrus.



/image%2F1490195%2F20180316%2Fob_343836_van-gogh-le-pont-du-carrousel-et-le.jpg)